Un besoin thérapeutique
Depuis très longtemps, les Hommes sont fascinés par la faune sauvage et la nature. Ils ont cette envie de tout contrôler et s’accaparer. Pourquoi ?
- Une raison biologique : Le biologiste Edward O. Wilson a formulé l’hypothèse de la biophilie : les humains auraient une tendance innée à rechercher des liens avec les autres formes de vie. Cette pulsion viendrait de notre évolution en milieu naturel : pendant des millions d’années, notre survie dépendait de notre capacité à comprendre, observer et vivre dans la nature. Ce qui signifie que que nous sommes prédisposés à nous sentir bien dans des environnements naturels.
- S’échapper du quotidien stressant : Dans les sociétés actuelles, l’environnement urbain, bruyant et artificiel est souvent source de stress. La nature offre calme, régularité, diversité sensorielle douce (bruits de l’eau, feuillage, lumière naturelle) qui aident le cerveau à se détendre. On observe que même de courtes immersions dans la nature (forêt, mer, animaux, ciel étoilé) réduisent le stress, l’anxiété et la fatigue mentale.
- Un besoin existentiel et spirituel : La nature évoque quelque chose de plus grand que soi : elle rappelle l’interdépendance, la beauté, la vie, la mort. Beaucoup de croyances spirituelles (chamanisme, taoïsme, philosophies autochtones,…) valorisent une connexion profonde à la nature comme voie de sagesse ou de guérison. Être dans la nature déconnecte des sollicitations numériques, permet de ralentir, de retrouver une attention plus intérieure. C’est souvent dans des milieux naturels que des gens disent « se retrouver » ou « faire le point ». La nature est inspirante.
La pandémie mondiale de la Covid-19, en contraignant les individus à rester confinés chez eux, a intensifié ce besoin de se reconnecter à la nature, de voyager autrement, loin des circuits traditionnels, et de rechercher une proximité plus authentique avec les animaux et les milieux naturels. Pourtant, c’est souvent au nom de cette quête sincère de sens et de bien-être que les animaux se retrouvent, malgré eux, instrumentalisés et placés dans des conditions préjudiciables à leur bien-être.
Ces pratiques sont encouragées par les prestataires, qui proposent aux visiteurs de prendre soin d’un animal sauvage comme s’il s’agissait d’un enfant. Cette approche conduit à une forme d’infantilisation de l’animal : on le caresse, on l’embrasse, on le brosse, on le nourrit… le tout selon un programme bien structuré, calqué sur nos propres habitudes humaines. L’animal en vient presque à être considéré comme un simple objet.
À force d’interactions répétées et souvent inappropriées avec les humains, les animaux finissent par modifier leur comportement naturel. Habitués à la présence constante de l’homme, ils peuvent devenir dépendants de ces contacts ou, au contraire, adopter des réactions de stress ou d’évitement. Cette surstimulation perturbe profondément leur équilibre social : elle les empêche d’entretenir des liens normaux avec leurs congénères, car l’humain prend une place centrale et artificielle dans leur quotidien, au détriment de leur vie sociale naturelle.
Les voyages spirituels

Un phénomène préoccupant émerge dans le domaine des voyages spirituels et de bien-être : des personnes se revendiquant “experts” ou “connaisseurs du monde animal” proposent des séjours incluant des interactions rapprochées avec la faune sauvage.
Sous couvert de spiritualité, d’intuition ou de “lecture comportementale”, ces pseudo-scientifiques justifient des pratiques intrusives, affirmant qu’ils comprennent les besoins des animaux, qu’ils savent “quand c’est le bon moment” ou qu’ils possèdent un lien particulier avec eux.
Le danger est double :
-
D’un côté, cela banalise l’intrusion humaine dans les espaces naturels, créant un modèle de consommation de la nature déguisé en expérience spirituelle.
-
De l’autre, cela dénature la démarche scientifique et éthique, en écartant les savoirs construits sur des années d’observation rigoureuse et de respect des protocoles d’approche.
Il est temps de remettre de la conscience dans ces démarches, en alliant éthique, connaissances fondées, et humilité face au vivant. La magie d’un regard échangé à distance, librement, vaut plus que n’importe quelle photo ou caresse volée.
Soyons également vigilants face à certains voyages spirituels. Il ne s’agit pas de rejeter toutes ces expériences, mais certains organisateurs, au nom de la « reconnexion avec les animaux », choisissent des lieux qui favorisent une interaction directe avec la faune sauvage.
Aimer profondément les animaux, c’est aussi respecter leur rythme de vie naturel. On peut ressentir un lien fort avec eux sans envahir leur espace, en gardant une juste distance. C’est dans cette retenue que se manifeste un vrai respect de leurs besoins biologiques et comportementaux.
Je suis convaincue qu’il est possible de concilier approche spirituelle et rigueur scientifique. Observer les règles d’approche et d’observation ne diminue en rien la magie du moment — au contraire, cela renforce la beauté et l’authenticité de la connexion que nous pouvons vivre avec le monde animal.
Des discours trompeurs
Le syndrome du sauveur
Les prestataires s’appuient souvent sur des récits de sauvetage — l’animal aurait été extrait de la maltraitance — pour justifier l’activité et inciter les visiteurs à y participer, en leur donnant le sentiment de contribuer à une bonne action. Cette mise en scène active chez l’humain un réflexe de « sauveur ». Pourtant, ce discours peut être trompeur : il induit les visiteurs en erreur, leur donnant l’illusion d’agir de manière éthique, alors qu’ils participent parfois, malgré eux, à un système problématique.
C’est pourquoi il est essentiel de s’interroger sur la nature même de l’offre proposée, car celle-ci est souvent révélatrice du niveau réel d’éthique de l’activité.
Apprivoisés et non domestiqués
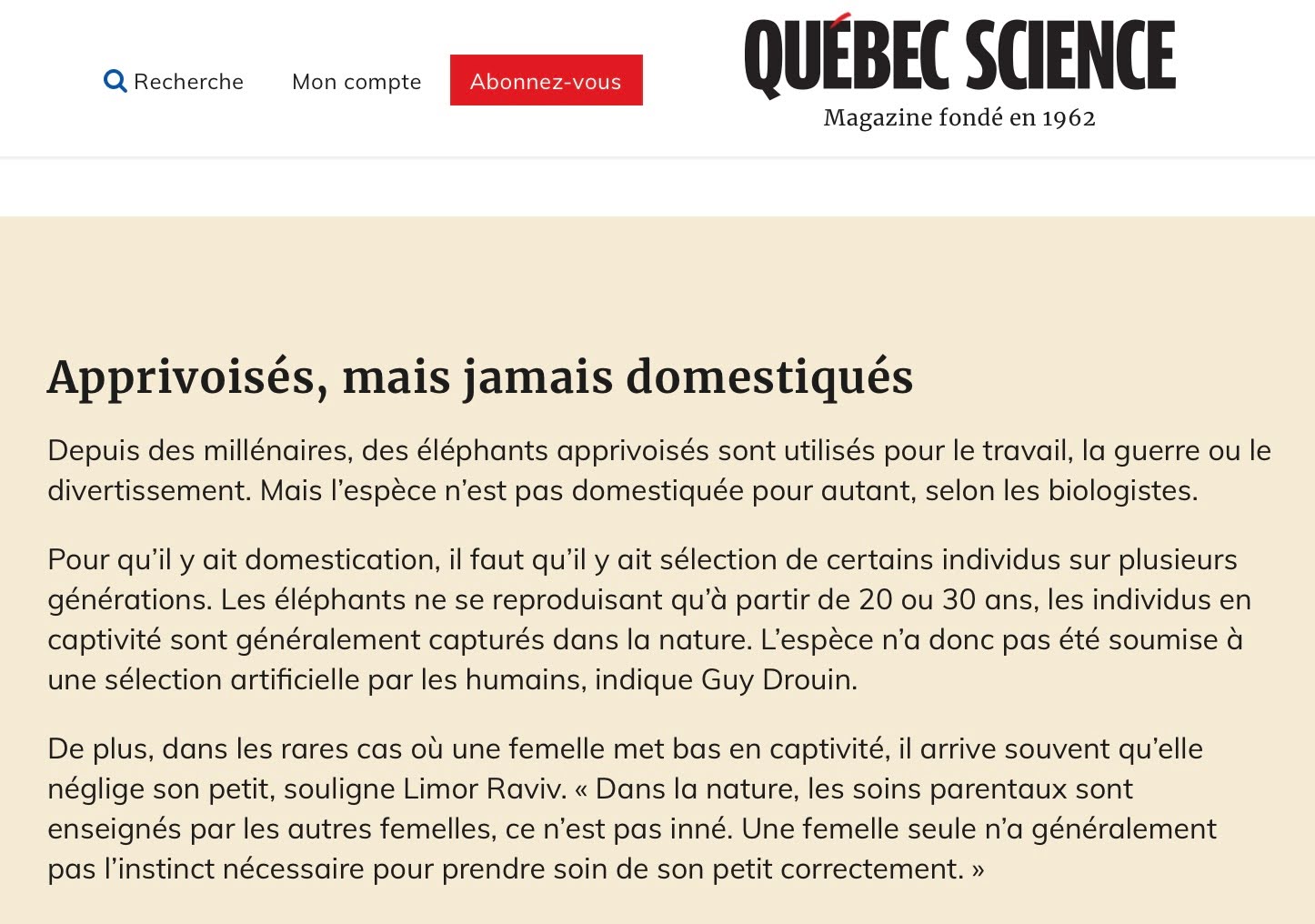
Lorsque l’on cherche à s’engager dans une activité, il est essentiel de maintenir un esprit critique, non pas dans une perspective négative, mais plutôt dans une démarche constructive. Il s’agit d’adopter une attitude d’amélioration continue, d’ouverture à l’apprentissage, et de développement d’une conscience plus profonde. Ce regard critique permet non seulement d’identifier les aspects à perfectionner, mais aussi d’assurer que nos actions sont alignées avec des valeurs éthiques et réfléchies.
Les conséquences de l’interaction
Pour rappel
Modification des comportements
Les interactions humaines fréquentes et invasives perturbent le comportement naturel des animaux sauvages. Ceux-ci peuvent devenir trop dépendants de l’homme ou, au contraire, développer des réactions d’évitement, de stress ou d’agression. L’animal, loin de pouvoir maintenir ses comportements sociaux avec ses congénères, peut perdre ses repères naturels, ce qui nuit à son bien-être psychologique et à sa capacité d’adaptation dans son habitat naturel.
Réveil de traumatismes
Pour certains animaux, ces interactions peuvent raviver des traumatismes passés. L’exposition constante à des humains peut activer des souvenirs douloureux de mauvais traitements ou de captivité, provoquant des réactions de peur, de méfiance ou de stress post-traumatique. Ces répercussions psychologiques peuvent être lourdes et affecter leur comportement à long terme.
Transmission de maladies (zoonoses)
Les contacts avec les humains augmentent aussi le risque de transmission de zoonoses, ces maladies qui peuvent être transmises entre les animaux et les humains. Des bactéries, virus ou parasites peuvent ainsi être échangés, mettant en danger non seulement la santé des animaux, mais aussi celle des visiteurs. La gestion de ces risques est souvent négligée dans de nombreuses interactions humaines avec la faune, rendant la situation encore plus préoccupante.
Réduction de l’autonomie
Un contact excessif avec les humains peut également conduire à une perte de compétences naturelles. Par exemple, un animal habitué à être nourri par l’homme peut perdre sa capacité à se nourrir seul, ce qui le rend vulnérable si jamais il est réintroduit dans la nature. Ce manque d’autonomie peut aussi affecter sa survie à long terme, surtout si l’animal est relâché dans un milieu sauvage.
Modification des comportements sociaux
Les animaux sauvages ont des interactions sociales complexes avec leurs congénères, et ces dynamiques sont cruciales pour leur équilibre et leur reproduction. Lorsque l’humain intervient trop fréquemment, l’animal peut perdre ses instincts sociaux naturels. Par exemple, un animal peut devenir plus solitaire ou plus agressif envers ses congénères, ce qui affecte le bon fonctionnement de son groupe social et peut perturber l’équilibre de l’écosystème dans lequel il évolue.
Dépendance affective
Dans certains cas, une dépendance affective peut se développer entre l’animal et l’humain, en particulier si l’animal est manipulé de manière régulière et non appropriée. Cela peut conduire à des comportements anxieux ou compulsifs lorsque l’animal est séparé de l’humain ou lorsqu’il n’a pas l’opportunité de retrouver son propre espace et ses habitudes.